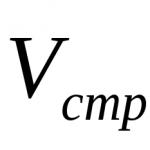Le concept et la signification du contrat. Accord (contrat) - concept, structure, conception
La notion de contrat. L'accord est le moyen le plus important (outre la publication des dispositions législatives) de réglementation juridique de la propriété et des relations non patrimoniales correspondantes.L’accord présente les principales caractéristiques suivantes.
La conclusion d'un accord entraîne l'établissement d'un lien juridique entre ses participants. La publication d'actes législatifs définissant des règles de conduite pour un large éventail de personnes ne donne pas lieu en soi à des relations entre elles. En revanche, la conclusion d'un contrat entraîne l'émergence d'une relation spécifique entre deux ou plusieurs entités. Le contrat remplit la fonction de nouer des liens juridiques entre les individus et sert d'instrument pour créer de tels liens.
* Auparavant, ces circonstances incluaient la modification ou la résiliation d'un acte prévu qui constituait la base de l'obligation (article 234 du Code civil). Mais ces actes devaient aussi être bilatéraux contraignants pour avoir un impact direct sur les relations civiles, ce qui était assez rare. Actuellement, une telle base de résiliation des obligations n’a aucune signification pratique.
rés. Les relations établies sur la base d'un accord se réalisent dans les actions des individus (moins souvent, en s'abstenant d'accomplir les actions pertinentes). Il peut s’agir, par exemple, du simple fait de regarder un film dans un cinéma ou du fait qu’un visiteur dépose des vêtements d’extérieur dans le vestiaire de l’institution. Les actions délibérées des sujets peuvent être de nature multi-liens complexes, comme, par exemple, dans les contrats de construction d'un bâtiment pour un client par un entrepreneur. Un accord peut prévoir la répétition répétée par ses participants d'un certain ensemble d'actions interdépendantes : expédition uniforme et paiement du coût des envois de marchandises dans le cadre d'un contrat de fourniture, exécution régulière par la banque des ordres des clients dans le cadre d'un contrat de service de règlement.
L'accord crée non seulement une interaction entre les sujets, mais détermine également les exigences relatives à l'ordre et à la séquence de leur exécution des actions nécessaires. Il remplit une fonction régulatrice - il prévoit un régime juridique pour le comportement des personnes dans le cadre du lien établi. Selon l'art. 158 du Code civil, le contrat sert de base à la naissance des obligations. Les droits établis par les parties au contrat et les obligations assumées organisent juridiquement cette relation et en font une obligation.
Un certain nombre de principes généraux et de principes de droit civil sont mis en œuvre dans l'accord. Les relations de ses participants sont basées sur l'égalité mutuelle. Lors de la conclusion et de l'exécution d'un accord, aucune des parties n'est soumise à l'autorité de l'autre.
Les contreparties contractuelles sont indépendantes les unes des autres, qu'elles soient des citoyens, des personnes morales, des entités nationales ou administratives-territoriales représentées par leurs autorités et leurs dirigeants.L'égalité juridique présuppose le caractère équivalent des relations entre les parties au contrat. Un contrat sert de « transaction économique » car l’accomplissement d’actions ou la fourniture d’un bien par une seule personne est généralement compensé par une contrepartie d’une valeur égale pour le destinataire.
L'égalité juridique et économique des personnes entrant dans une relation contractuelle détermine la circonstance importante suivante. Un contrat naît d'un accord entre ses participants et nécessite de parvenir à un accord sur la conclusion d'une obligation et d'en déterminer les termes. Une dérogation au principe du caractère volontaire et obligatoire de la conclusion de contrats n'est possible que dans les cas prévus par la loi et s'applique principalement aux organisations qui occupent une position de monopole sur le marché des biens ou des services.
L'exercice des droits prévus dans le contrat et le respect des obligations sont assurés par des mesures d'influence étatique-organisationnelle. La mise en œuvre des contrats repose sur la possibilité de coercition, caractéristique de la régulation juridique en général.
Un contrat est un accord entre deux ou plusieurs personnes pour effectuer certaines actions et établir des droits et obligations mutuels régissant ces actions, dont la mise en œuvre est assurée par des mesures coercitives organisées par l'État.
Il est important de déterminer la relation du contrat avec des catégories juridiques telles que la transaction et l'obligation.
Un contrat est généralement interprété comme une transaction bilatérale ou multilatérale. Mais réduire un contrat à une transaction n’est guère correct. Une transaction est une action visant à établir, modifier, mettre fin à des droits ou à des obligations (article 41 du Code civil). L'accord établit non seulement des droits et des obligations, mais prévoit également l'accomplissement d'actions substantielles par les sujets, dont le contenu est fixé dans l'accord. Le contrat définit exactement ce qui doit être fait et quelles sont les exigences légales auxquelles les parties doivent répondre pour exécuter les actions. Par conséquent, le rôle et les fonctions du contrat sont beaucoup plus larges que ceux d’une transaction traditionnellement comprise.
Quant à la relation entre le contrat et l'obligation, alors, selon l'art. 158 du Code civil, un accord est reconnu comme l'un des motifs de naissance des droits et obligations, obligations civiles. C'est le contrat qui détermine quelles actions doivent être accomplies par le débiteur pour le créancier. Il donne à l'obligation une « force juridique », qui consiste en la possibilité d'appliquer des mesures coercitives pour garantir que le débiteur remplisse les obligations stipulées.
Il est important de déterminer la relation entre la loi et le pouvoir discrétionnaire des parties lorsqu'elles conviennent des droits et obligations dans un contrat. Le contenu du contrat est, à un degré ou à un autre, directement déterminé par la loi ou formé en tenant compte des dispositions réglementaires. En pratique, les règles de droit ne sont pas incluses dans le texte du contrat, puisqu'une telle reproduction de la loi n'est pas nécessaire et ne correspond pas à l'essence du contrat comme moyen de régulation des relations privées. La discrétion des parties, leur accord sur la composition et la procédure d'exécution des actions, en tenant compte de leurs intérêts et de leurs capacités, sont d'une importance décisive pour l'élaboration des conditions contractuelles.
Sur la base de la nature de l'influence de la législation sur la détermination du contenu des obligations, les termes suivants du contrat peuvent être distingués : juridiques-factuels et normatifs.
Les termes juridico-factuels doivent être compris comme les termes du contrat perçus par les parties à partir des actes législatifs. Ces conditions peuvent à leur tour être divisées en trois sous-groupes.
Premièrement, il s'agit de conditions dont la conclusion d'un accord entraîne l'obligation pour les parties de se laisser guider par les normes juridiques relatives à la condition acceptée. Par exemple, l'inclusion dans un contrat d'une condition selon laquelle les paiements des marchandises vendues seront effectués au moyen d'ordres de paiement implique pour les contreparties la nécessité de se guider par les dispositions pertinentes des règles des paiements autres qu'en espèces dans l'économie nationale. De même, parvenir à un accord sur la livraison de marchandises par bagages par chemin de fer oblige les parties à respecter les règles de transport applicables au transport des bagages.
Deuxièmement, les dispositions législatives relatives aux types de contrats concernés peuvent être de nature juridique et factuelle.
Les normes dispositif sont répandues dans la législation civile. La présence d'une telle règle signifie que si la condition correspondante n'est pas incluse dans le contrat, les parties sont tenues de suivre
la règle prévue à cet égard par la loi. Peu importe que ce problème n'ait pas été résolu par les contreparties ou qu'elles n'aient pas pu élaborer une version convenue de la clause et aient décidé de se laisser guider par le modèle de comportement proposé dans l'acte réglementaire.
Ainsi, selon l'art. 285 du Code civil, le locataire est tenu de maintenir en bon état le bien reçu dans le cadre du contrat de location et d'effectuer les réparations courantes à ses frais, à moins qu'il n'ait été établi d'un commun accord entre les parties que ces obligations sont remplies par le propriétaire.
Troisièmement, un sous-groupe important est constitué de conditions élaborées en précisant les dispositions législatives. Les actes législatifs contiennent de nombreuses règles régissant certaines questions de relations contractuelles. Cependant, dans de nombreux cas, ils sont formulés de manière générale et ne peuvent être appliqués sans clarification ou détail par rapport aux conditions de fonctionnement et aux intérêts des sujets. Par exemple, indiquer dans le contrat le numéro de la norme à laquelle doit répondre la qualité du produit vendu impose aux parties de préciser des indicateurs caractérisant les propriétés de consommation du produit (tailles, modèles, marques, recettes, etc.).
Dans la littérature juridique, un contrat est souvent classé comme un fait juridique. L'étude du lien entre les dispositions législatives et le contenu des contrats révèle l'inexactitude et l'incomplétude de ces vues. Un fait juridique ne fait que mettre en mouvement la loi, permet aux sujets d'exercer des droits et d'exiger le respect d'obligations dont la survenance est prévue par la loi dans le cas correspondant. En revanche, lors de la conclusion d'un accord, les parties développent indépendamment des droits et obligations mutuels sur des questions non réglementées par la loi et précisent les dispositions générales de la loi.
Il faut également tenir compte du fait qu'un fait juridique exprime une action ou un événement accompli. En revanche, les termes juridiques et factuels du contrat sont tournés vers l'avenir et visent à réguler les activités à venir des contreparties.
Les conditions de formation des règles sont développées par les sujets de manière indépendante. Dans certains cas, la loi peut indiquer la possibilité ou l'opportunité d'inclure de telles conditions dans un contrat, sans toutefois en définir le contenu. Les parties ont le droit de prévoir dans le contrat toutes conditions sur des questions qui ne sont généralement pas mentionnées dans la législation. Les conditions acceptées représentent un programme juridique pour les activités futures des parties à l'accord.
Les conditions juridiques, factuelles et normatives sont précisées dans le contrat sous la forme de ses clauses.
Il n'y a aucune différence entre ces types de conditions dans les contrats eux-mêmes. Cependant, ils doivent être différenciés en raison des différences significatives dans la procédure d'élaboration de ces conditions et d'autres, et dans les modalités de prise en compte des dispositions de la loi.Les droits et obligations prévus sur la base des accords se caractérisent par un certain nombre de caractéristiques qui expriment les spécificités de la régulation contractuelle. Ces droits et obligations concernent uniquement les parties au contrat et ne lient pas les autres personnes, sauf disposition contraire de la loi ou d'un accord avec des tiers. La durée d'existence des droits et obligations contractuels est inférieure à la durée
validité des dispositions législatives et est limitée par la durée du contrat lui-même.
Les contreparties soutiennent l'exécution du contrat par des mesures de responsabilité patrimoniale, si elles ne sont pas établies par la loi. Les parties peuvent en outre prévoir d'autres moyens pour assurer le respect de l'obligation.
L'État, représenté par le pouvoir judiciaire, assure la protection des droits des contreparties contre les violations et les actions inappropriées. Ces droits sont protégés au même titre que les droits fondés sur les normes juridiques. Dans la pratique judiciaire, il n'y a pas de distinction entre la protection des droits prévue par la loi ou par accord des parties. Dans les conditions de sa validité, un accord, comme une loi, sert de moyen de régulation juridique de la vie de la société civile.
Contrat et organisation d'une économie de marché. L'accord est appelé à jouer un rôle important dans la formation et le développement d'une économie de marché. Dans des conditions de marché, la production et les échanges ne sont pas régis par des actes administratifs des organes directeurs, mais par l'intérêt personnel et l'initiative des individus. L'accord permet aux entités commerciales d'établir de manière indépendante une coopération en matière de production, d'établir des connexions pour l'échange de biens et de services et de mener diverses activités commerciales. Il joue le rôle d'un moyen qui subordonne les actions des individus et les oriente vers la réalisation d'objectifs compatibles avec les intérêts de l'ensemble de la société.
L'établissement volontaire de relations contractuelles crée les conditions d'un échange équivalent, garantissant la justification économique et la rationalité des actions des sujets et réduisant les coûts. Les fabricants commencent à se concentrer directement sur la satisfaction des demandes des consommateurs et prennent rapidement en compte l’évolution de la demande des consommateurs. Les conditions sont créées pour la compétition, la compétitivité™ afin d'obtenir de meilleurs résultats.
Un contrat définit la relation entre deux ou plusieurs entités spécifiques. Cela permet de réglementer légalement les aspects de leur relation qui ne peuvent être réglementés sur la base de règles généralement contraignantes. Les contreparties peuvent prévoir dans les contrats des solutions mutuellement acceptables à diverses questions de modernisation de la production, d'introduction de réalisations scientifiques et techniques, de développement de la production de nouveaux types de produits, d'amélioration constante de leur qualité, etc.
L'ensemble des accords conclus pour l'échange des résultats de production et d'autres activités constitue le noyau du mécanisme de marché et constitue son contenu principal. La privatisation des entreprises publiques, l'introduction de prix libres, d'impôts, de crédits et d'autres mesures visent uniquement à créer les conditions nécessaires à l'établissement et à la mise en œuvre normales de relations contractuelles de marché.
Jusqu'à ces dernières années, presque tous les produits et biens fabriqués par les entreprises étaient distribués par les autorités de planification. L’abandon de la régulation centralisée de la production et des échanges a nécessité la mise en œuvre de mesures à l’échelle nationale pour rétablir des relations économiques sur la base du volontariat et de l’équivalence. Les retards dans la résolution de ce problème entraînent des interruptions de l'approvisionnement en matériaux et produits de base, une baisse
production, hausse des prix. Des efforts importants sont nécessaires pour restructurer l'ensemble du système de relations contractuelles et économiques sur la base du volontariat et de l'intérêt mutuel, en leur donnant un caractère de marché.
Discipline contractuelle. La liberté de conclure des contrats et de déterminer leur contenu est inextricablement liée à l'obligation de remplir les conditions acceptées. L'accord prévoit les droits et obligations légales de ses participants. Le non-respect des termes du contrat constitue donc une infraction. Dans le même temps, de telles actions inappropriées ne peuvent être qualifiées de violations de la loi, puisque les droits et obligations contractuels sont développés par les contreparties elles-mêmes et non établis par la loi. Ce n'est que si le participant à l'obligation s'est écarté des exigences de la loi que ses actes peuvent être considérés comme une violation de la loi.
Dans le même temps, garantir l’exécution précise et en temps opportun des obligations contractuelles est une tâche d’importance nationale. Le renforcement de la discipline contractuelle recèle d’énormes réserves pour accroître l’efficacité économique. En raison du non-respect des obligations, le potentiel de production existant n'est pas pleinement utilisé et des dépenses irrationnelles de matériaux, de forces publiques et de fonds sont autorisées. La fiabilité des relations contractuelles et l'augmentation de leur stabilité sont un facteur de développement des relations marchandes.
Les réponses aux tâches 1 à 20 sont un nombre, ou une séquence de nombres, ou un mot (expression). Écrivez vos réponses dans les champs à droite du numéro de devoir sans espaces, virgules ou autres caractères supplémentaires.
1
Notez le mot manquant dans le tableau.
Structure d'une norme juridique
2
Dans la ligne ci-dessous, trouvez un concept qui généralise à tous les autres concepts présentés. Écrivez ce mot.
1) Points de vue 2) idéaux 3) principes 4) vision du monde 5) valeurs.
3
Vous trouverez ci-dessous une liste de caractéristiques. Tous, à l’exception de deux, concernent les caractéristiques de l’art.
1) fiabilité des résultats 2) imagerie 3) désir de rechercher des connaissances objectives 4) émotivité 5) visibilité 6) activité créative
Énumérez ces deux caractéristiques.
4
Indiquez les jugements corrects sur les impôts.
1. Les impôts indirects sont payés exclusivement par les personnes morales.
2. Les impôts directs sont perçus sur les revenus, la propriété et certains types d'activités des citoyens et des entreprises.
3. Les droits d'accise constituent le principal type d'impôts directs.
4. Selon l'usage, les taxes peuvent être générales ou individuelles.
5. Les impôts locaux dans la Fédération de Russie comprennent l'impôt foncier.
5
Établir une correspondance entre les termes du contrat de travail (indiqués par des lettres) et son type (indiqué par des chiffres).
6
L'État B est une confédération. Quelles sont les caractéristiques d’une confédération ?
1. Il s’agit d’une union d’États souverains créée pour atteindre des objectifs communs spécifiques.
2. La Confédération comprend la métropole et les colonies.
3. Les sujets de la confédération ne peuvent avoir leur propre législation.
4. La confédération manque d'organes législatifs et de systèmes de gouvernance communs.
5. La Confédération a des territoires et des frontières étatiques communes à tous ses sujets.
6. La confédération a une Constitution, une législation, une citoyenneté et un système financier communs à tous les participants.
7
Sélectionnez les énoncés corrects sur les caractéristiques distinctives d'une économie de marché et notez les chiffres sous lesquels ils sont indiqués.
1. L'État procède à une répartition centralisée des ressources.
2. Les prix des biens et services sont déterminés par la relation entre l'offre et la demande.
3. Les entreprises doivent faire face au problème des ressources limitées.
4. Les producteurs de biens et de services sont en concurrence pour répondre à la demande des consommateurs.
5. Toute personne a le droit de disposer librement de ses capacités et de ses biens pour mener des activités entrepreneuriales et autres activités économiques non interdites par la loi.
8
Établir une correspondance entre les fonctions et les banques qui les exercent.
9
Dans le village de A., une ferme fournit des produits alimentaires aux magasins ; les autres producteurs ne sont pas représentés. Sélectionnez les caractéristiques de ce marché dans la liste ci-dessous et notez les numéros sous lesquels ils sont indiqués.
1. marché des biens
2. marché local
3. oligopole
4. marché du travail
5. production excédentaire
6. monopole
10
Une enquête sociale a été menée dans une ville cosmopolite. Les personnes interrogées étaient des citoyens âgés de 30 et 60 ans. Ils ont répondu à la question « A votre avis, quel devrait être le comportement des représentants des différents groupes ethniques vivant sur un même territoire afin de prévenir les conflits interethniques ? » Les résultats de l'enquête (en pourcentage du nombre de répondants) sont présentés dans le diagramme.
Analyser les informations reçues. Quelles conclusions peut-on tirer du schéma ?
1. La plus grande proportion de jeunes considère qu’apprendre à trouver une langue commune est l’aspect le plus important.
2. La proportion de ceux qui pensent que pour prévenir les conflits interethniques il faut apprendre à se comprendre est plus élevée chez les 60 ans que chez les 30 ans.
3. Des parts égales de personnes interrogées dans les deux groupes estiment que pour prévenir les conflits interethniques, il est nécessaire de mieux connaître la culture des autres groupes ethniques.
4. La plus faible proportion de répondants des deux groupes n'a pas réfléchi à la question posée.
5. La moitié des trentenaires interrogés estiment que le respect des droits et libertés de chacun contribuera à prévenir les conflits interethniques.
11
Choisissez les jugements corrects qui caractérisent les caractéristiques des normes sociales.
1. Les normes sociales reflètent les concepts de valeurs de la société.
2. Les traditions et coutumes sont des types de normes sociales.
3. Les coutumes et traditions sont toujours inscrites dans les lois.
4. Le respect des normes morales est assuré par le pouvoir de l'État.
5. Les règles de conduite fondées sur les idées de la société sur le bien et le mal, le mal et le bien, sont appelées normes d’entreprise.
6. Contrairement aux coutumes, les normes morales sont consignées dans des sources écrites.
12
Dans le pays Q, une étude sociologique a été menée sur la répartition des tâches ménagères entre les hommes et les femmes. La question posée aux personnes interrogées était la suivante : « Effectuez-vous personnellement des tâches ménagères ? Si oui, combien de temps cela vous prend-il ?
Les résultats de l'enquête (en pourcentage du nombre de répondants) sont présentés dans le diagramme.

1. Un cinquième des hommes ayant participé à l'enquête ne font pas de travaux ménagers.
2. Parmi les femmes, la part de celles dont les tâches ménagères prennent peu de temps est supérieure à la part de celles qui y consacrent beaucoup de temps.
3. Des parts égales d’hommes et de femmes ont eu du mal à répondre.
4. Plus d'un tiers des hommes interrogés ont répondu que les tâches ménagères prenaient beaucoup de temps.
5. Parmi les femmes, la proportion de celles qui ont eu des difficultés à répondre est supérieure à celle de celles qui ne font pas de travaux ménagers.
13
Choisissez les jugements corrects sur l'État.
1. L'État a le droit de percevoir des impôts et des taxes auprès de la population.
2. Les lois et pouvoirs de l'État s'appliquent uniquement à ses citoyens vivant sur un certain territoire.
3. Disponibilité d'une langue officielle unique comme moyen de communication.
4. Protéger les intérêts des groupes individuels et des couches sociales.
5. La suprématie du pouvoir d'État à l'intérieur du pays et l'indépendance dans les relations extérieures.
14
Établir une correspondance entre les fonctions du pouvoir de l'État et les entités qui les exercent : pour chaque poste indiqué dans la première colonne, sélectionner le poste correspondant dans la deuxième colonne.
15
La Constitution de la Fédération de Russie prévoit la protection des droits et libertés de l'homme et du citoyen. Parmi les droits suivants, lesquels sont des droits sociaux ?
1. le droit de voter et d'être élu
2. droit aux soins de santé
3. droit à l'activité entrepreneuriale
4. droit à l'éducation
5. le droit de participer à l'administration de la justice
6. droit à un environnement favorable
16
Lequel des exemples suivants illustre le fonctionnement de la société civile ?
1. Le ministère des Sciences et de l'Éducation a annoncé l'organisation d'un concours étudiant « Expert en langue russe ».
2. La majorité des citoyens du pays sont adeptes d'une seule religion.
3. Dans tout le pays, les citoyens participent activement aux élections locales.
4. La police de la circulation a donné des conférences aux étudiants sur l'importance du respect des règles de la circulation.
5. Lors d'une réunion des habitants d'une petite ville, il a été décidé d'améliorer la friche et d'y planter des plantes ornementales.
17
Établir une correspondance entre les pouvoirs (indiqués par des lettres) et le type de banques (indiqués par des chiffres) du système électoral.
18
La société est un système complexe. Quels signes nous permettent de tirer des conclusions appropriées ?
1. isolement de la nature
2. modes d'interaction entre les personnes
3. maintenir un lien avec la nature
4. une partie du monde matériel
5. présence de certaines traditions
6. hiérarchie des positions sociales
19
Les futurs époux, citoyens de la Fédération de Russie Neznayka et Romashka, se sont tournés vers un notaire pour conclure un contrat de mariage. Retrouvez dans la liste ci-dessous les dispositions pour lesquelles le notaire a refusé d'authentifier l'acte pour les époux. Sélectionnez les éléments requis dans la liste fournie et notez les numéros sous lesquels ils sont indiqués.
1) l'accord prévoit le régime de la séparation des biens des époux
2) les droits des époux vis-à-vis des futurs enfants sont indiqués
3) les devoirs de la femme envers les parents du mari sont déterminés
4) le lieu de résidence des époux est enregistré
5) Je ne sais pas et Romashka n'ont pas enregistré leur mariage
6) les modes de participation de Dunno et Romashka aux revenus de chacun sont nommés
Lisez le texte ci-dessous, dans lequel il manque un certain nombre de mots. Sélectionnez dans la liste fournie les mots qui doivent être insérés à la place des espaces.
20
L'émergence d'une communauté sociale telle que ______ (A) est associée au développement des relations capitalistes. Les scientifiques modernes pensent que la caractéristique clé de cette communauté est une communauté de culture spirituelle, dont un élément important est le ______ national (B). Les principales orientations du développement des relations interethniques sont le ______ (B) et la différenciation. La coopération interethnique peut être menée dans divers domaines : économique, politique, ______ (D), spirituel. Les causes des ______ (D) interethniques peuvent être : des préjugés quotidiens, des conflits territoriaux, ______ (E) pour des raisons raciales et religieuses.
Les mots (expressions) de la liste sont donnés au nominatif. Chaque mot (expression) ne peut être utilisé qu'une seule fois.
Sélectionnez un mot (expression) après l'autre, en comblant mentalement chaque lacune. Veuillez noter qu'il y a plus de mots (expressions) dans la liste que vous n'en aurez besoin pour combler les lacunes.
Liste des termes :
1. intégration
2. nationalisme
3. sociale
4. conflits
5. discrimination
6. humanisation
8. tradition
9. conscience de soi
Partie 2.
Notez d'abord le numéro de la tâche (28, 29, etc.), puis une réponse détaillée. Écrivez vos réponses de manière claire et lisible.
Lisez le texte et effectuez les tâches 21 à 24.
L'accord est le moyen le plus important (en plus des règlements publiés) de réglementation juridique des relations entre les membres de la société.
Un contrat est un accord entre deux ou plusieurs personnes visant à établir des droits et obligations civils.
Un contrat est déterminé par la présence d'un certain nombre de caractéristiques inhérentes. La conclusion d'un accord conduit à l'établissement d'un lien juridique (relation juridique) entre ses participants. Les actes juridiques réglementaires publiés déterminent les règles de conduite pour un large éventail de personnes. En revanche, la conclusion d'un contrat entraîne l'émergence d'une relation spécifique entre deux ou plusieurs entités. Le contrat sert à créer des liens juridiques entre les individus et constitue un outil permettant d'établir de tels liens.
Le contenu de la relation contractuelle est la mise en œuvre d'actions conduisant à la réalisation des objectifs des parties à l'accord, à la satisfaction de leurs intérêts économiques et autres. Les relations établies sur la base du contrat s'expriment dans les actions des personnes. Il peut s’agir, par exemple, d’actions ponctuelles consistant à assister à une représentation dans un théâtre ou à un visiteur déposant un manteau dans le vestiaire de l’institut.
Les actions délibérées des sujets peuvent être de nature complexe à plusieurs liens, comme, par exemple, les actions d'un organisme de construction dans le cadre d'un contrat avec un client pour la construction d'un bâtiment. L'accord peut prévoir la répétition répétée par ses participants de certaines actions interdépendantes : expédition régulière de produits de boulangerie par l'entreprise au magasin et paiement par ce dernier de leur coût au titre du contrat de fourniture de biens, exécution constante par la banque de les ordres du client au titre de la convention de compte bancaire.
L'accord crée non seulement une relation juridique entre les sujets, mais établit également des exigences concernant l'ordre et la séquence des actions nécessaires qu'ils effectuent.
L'exécution des contrats en général repose sur la possibilité de coercition de la part des organes judiciaires et autres organismes gouvernementaux, ce qui est caractéristique de la réglementation juridique en général.
Ainsi, un contrat est un accord de deux ou plusieurs personnes sur la mise en œuvre d'actions interdépendantes ciblées et l'établissement de droits et obligations mutuels régissant ces actions, dont la mise en œuvre est assurée par des mesures de coercition organisées par l'État.
Les parties (participants) à l'accord peuvent être des personnes physiques dotées de la capacité juridique, des organisations qui sont des personnes morales et d'autres sujets de droit.
(B.I. Pouginski)
Quelle définition de la notion de « contrat » donne l’auteur ? Quelles caractéristiques (signes) du contrat met-il en avant ?
Montrer la réponse
OU « un accord entre deux ou plusieurs personnes établissant des droits et obligations civils » ;
2) des signes, par exemple :
Établissement d'un lien juridique (relation juridique) entre ses participants ;
Détermination des actions conduisant à la réalisation des objectifs des parties à l'accord ;
Établir des exigences pour l'ordre et la séquence des actions nécessaires
Montrer la réponse
La bonne réponse doit contenir les éléments suivants :
1) similitudes :
l'exécution des contrats et des règlements repose sur la possibilité de coercition de la part des organes judiciaires et autres organismes gouvernementaux ;
2) différence :
les actes juridiques réglementaires déterminent les règles de comportement pour un large éventail de personnes, et la conclusion d'un accord entraîne l'émergence d'une relation spécifique entre deux ou plusieurs entités.
Quels types d'actions peuvent devenir le contenu des relations contractuelles ? Indiquez celui de l'auteur et donnez votre propre exemple de telles actions.
Montrer la réponse
La bonne réponse doit contenir les éléments suivants :
1) types d'actions :
Actions uniques ;
Actions à caractère multi-liens complexes ;
Actions répétées;
Actions uniques consistant à assister à une représentation dans un théâtre ou à déposer un manteau par un visiteur au vestiaire de l’institut ;
Actions multi-liens d'un organisme de construction dans un contrat avec un client pour la construction d'un bâtiment ;
Expédition régulière des produits de boulangerie par l'entreprise jusqu'au magasin et paiement par ce dernier de leur coût au titre du contrat de fourniture des biens ;
3) propre exemple, disons :
paiement régulier du loyer de l'appartement par le locataire conformément au contrat de location.
Sur la base de vos connaissances, donnez un exemple de n’importe quel contrat. Indiquer ses participants et les relations que l'accord régit, ainsi que les droits et obligations des parties qui en découlent.
Montrer la réponse
La bonne réponse doit contenir les éléments :
1) un exemple de contrat (par exemple, un contrat de mariage) ;
2) ses participants (conjoint) ;
3) les relations que l'accord régit (relations de propriété) ;
4) droits et obligations des parties (droits patrimoniaux et obligations des époux dans le mariage et (ou) en cas de dissolution)
Quel sens les spécialistes des sciences sociales donnent-ils au concept d’« activité » ? En utilisant les connaissances du cours de sciences sociales, faites deux phrases : une phrase contenant des informations sur les types d'activités et une phrase révélant l'essence d'un des types d'activités.
Montrer la réponse
La bonne réponse doit contenir les éléments suivants :
1) le sens du concept, par exemple : « activité humaine visant à satisfaire des besoins et régulée par un objectif conscient » ;
(Une autre définition de sens similaire peut être donnée.)
2) une phrase contenant des informations sur les types d'activités basées sur la connaissance du cours, par exemple : « Il existe de nombreuses classifications de l'activité humaine, y compris l'identification de ses trois principaux types : travail, apprentissage, jeu » ;
(Toute autre proposition contenant des informations sur les types d'activités peut être élaborée.)
3) une phrase révélant l'essence d'un des types d'activités, par exemple : « L'enseignement vise à maîtriser les connaissances, à acquérir des compétences et des capacités.
(Toute autre phrase peut être faite qui révèle l'essence de l'un des types d'activités.)
Les propositions doivent être formulées correctement et ne pas contenir d'éléments qui déforment le sens du concept et/ou ses aspects.
Les phrases contenant des erreurs essentielles ne sont pas prises en compte lors de la notation.
Nommez deux facteurs de demande autres que le prix et illustrez par des exemples l’effet de chacun d’eux.
Montrer la réponse
La réponse peut nommer et illustrer, par exemple, les facteurs suivants :
1) Nombre de consommateurs - par exemple, dans le commerce international, le nombre de consommateurs augmente lorsque les produits sont promus sur les marchés d'autres pays, ce qui entraîne une augmentation significative de la demande ;
2) prix des biens de substitution, par exemple des téléviseurs de différents fabricants, différentes marques de voitures - une augmentation du prix des biens de substitution entraîne une augmentation de la demande pour le produit remplacé, une diminution du prix des produits de substitution entraîne une diminution de la demande pour ce produit ;
3) les attentes des consommateurs - par exemple, dans des situations économiques extrêmes, la demande de biens essentiels (sel, allumettes, savon) augmente considérablement, car les acheteurs ont peur qu'ils disparaissent des étagères ;
4) les prix des biens complémentaires, par exemple pour les appareils photo, il s'agira de films photographiques ou de cartes mémoire - si les prix des cartes mémoire augmentent de manière significative, alors la demande d'appareils photo numériques diminuera, et vice versa.
Dans l'un des manuels, ce phénomène est révélé comme suit : « Un ensemble de moyens et de techniques par lesquels la société garantit que le comportement de ses membres, des sujets individuels de gestion et des groupes sociaux sera effectué conformément aux normes sociales établies et valeurs." Nommez le phénomène social évoqué dans le texte. En utilisant les connaissances du cours de sciences sociales, donnez deux de ses éléments et illustrez par un exemple l'un (n'importe lequel) d'entre eux.
1. Définition du concept de PIB - un indicateur macroéconomique qui reflète la valeur marchande de tous les biens et services finaux.
2. Méthodes de calcul du PIB.
a) Calcul basé sur le revenu.
b) Calcul des dépenses.
3. Expression du PIB.
a) PIB nominal.
b) PIB réel.
c) Monnaie nationale, ratio monétaire, taux de change.
4. PIB et PNB.
a) Le PNB comme principal indicateur de l'état de l'économie (jusqu'en 1991).
b) La valeur de l'indicateur PIB du pays.
5. Calcul du PIB par habitant.
Un nombre différent et (ou) une autre formulation correcte des points et sous-points du plan sont possibles. Ils peuvent être présentés sous des formes nominales, interrogatives ou mixtes.
En accomplissant la tâche 29, vous pouvez démontrer vos connaissances et vos compétences sur le contenu qui vous intéresse le plus. À cette fin, sélectionnez UN seul des énoncés ci-dessous (29.1-29.5).
Choisissez l'une des affirmations proposées ci-dessous, révélez son sens sous forme de mini-essai, en indiquant, si nécessaire, différents aspects de la problématique posée par l'auteur (le sujet évoqué).
Lorsque vous exprimez vos réflexions sur le problème soulevé (sujet désigné), lorsque vous argumentez votre point de vue, utilisez les connaissances acquises lors de l'étude du cours d'études sociales, les concepts pertinents, ainsi que les faits de la vie sociale et votre propre expérience de vie. (Donnez au moins deux exemples provenant de sources différentes pour une argumentation factuelle.)
29.1. Philosophie"Plus votre logique est mauvaise, plus les conséquences auxquelles elle peut conduire sont intéressantes." (B. Russell)
29.2. Économie« Le capital est une force productive morte qui, comme un vampire, ne vit que lorsqu’il absorbe la force de travail vivante, et plus il vit, plus il absorbe de travail. » (Karl Marx)
29.3. Sociologie, psychologie sociale"Emportez-le avec vous pour ne pas tomber en marchant." (sagesse russe)
29.4. Science politique"Peu importe comment ils ont voté, ce qui compte, c'est la façon dont ils ont compté." (I.V. Staline)
29.5. Jurisprudence« Oui, les forts ont des droits. Ils sont souvent aveugles.
Ils ont leur propre charte pour cela :
Celui qui gagne a raison.
Dans la législation et la pratique de son application, le terme « accord » (désignant un contrat civil) est utilisé dans au moins quatre sens : en tant qu'accord, en tant que document, en tant que relation juridique obligatoire et en tant que concept intégré (complexe).
Un contrat en tant qu'accord est le concept le plus courant et le plus fréquemment utilisé en droit et dans la pratique. En ce sens, la notion de contrat a reçu une définition juridique : « Un contrat est un accord entre deux ou plusieurs personnes portant sur l'établissement, la modification ou la cessation de droits et obligations de caractère civil. »
Définir un contrat en termes d’accord a un certain nombre d’implications importantes.
D'abord. Le concept de contrat est réduit au concept de fait juridique en tant que type de transaction. L'accord lui-même ne constitue pas encore une relation contractuelle entre les parties concernées. Son objectif est uniquement de l'établir. Étant le résultat d'une coïncidence mutuelle de la volonté des parties d'atteindre l'objectif spécifié, l'accord remplit une fonction très importante. Il définit le modèle de relation juridique née d'un contrat comme un accord. Ce modèle s’impose aux parties, car assuré par des sanctions légales.
Deuxième. L'accord doit porter sur l'ensemble des contrats d'un type précis (achat et vente, prêt, contrat, etc.), et non sur les conditions qui ne constituent que des éléments individuels de ces contrats. Le législateur poursuit systématiquement l'utilisation de la notion de contrat en tant qu'accord (fait juridique) uniquement en relation avec le stade d'émergence de la relation juridique correspondante. Dans le même temps, le terme « accord » est utilisé dans un sens plus large, étendant son effet également au stade du changement et de la cessation de la relation juridique découlant de l'accord. Des modifications et une prolongation de l'accord sont possibles par accord des parties, non appelé accord. Dans la pratique contractuelle, ces accords sont généralement appelés accords complémentaires.
Nous pouvons dire que tout contrat est un accord, mais tout accord ne s’appelle pas un contrat.
Troisième. Selon le droit russe, les contrats sont reconnus à la fois comme des accords entre les parties prévoyant l'exécution future des obligations assignées au débiteur et comme des accords signés dès leur achèvement. La deuxième catégorie d'accords sous forme générale de transactions est exécutée dès leur achèvement. De telles transactions peuvent notamment inclure un contrat de donation, dans lequel la chose est transférée en propriété une fois achevée, ou un contrat de transport de marchandises. Essentiellement, dans ce cas, nous parlons de tous les contrats réels qui sont tels par définition de la loi ou stipulés lors de la conclusion d'un accord par les parties elles-mêmes. La conception anglo-américaine du contrat comme promesse tournée vers l'avenir à partir du moment où le contrat est conclu n'est pas appliquée dans le droit civil russe.
De même, la législation civile actuelle de la Fédération de Russie ne distingue pas comme type distinct les contrats dits réels, sur la base desquels les droits de propriété sont transférés et les nouveaux propriétaires sont légalisés devant des tiers.
Le transfert de propriété d'une personne à une autre conformément au Code civil (ci-après dénommé le Code civil) s'effectue dans le cadre d'un contrat relevant du droit des obligations. La légalisation du nouveau propriétaire devant des tiers en ce qui concerne les biens immobiliers s'effectue par l'enregistrement public des droits de propriété et par l'accord sur la base duquel la propriété a été transférée dans le registre d'État unifié tenu par les institutions judiciaires.
La notion de contrat en tant que document est utilisée en relation avec la forme écrite des relations contractuelles entre les parties. Et bien qu'un tel concept soit absent du Code civil, il est largement utilisé dans les règlements, ainsi que dans la pratique commerciale et judiciaire, notamment lors de l'interprétation des termes du contrat contenu dans un accord - un document. L'un des fondements juridiques de la notion de contrat considérée réside dans les dispositions relatives à la forme du contrat. La loi prévoit la conclusion d'un accord sous la forme d'un document unique ou de documents mutuels émanant des parties à l'accord.
La notion de contrat en tant que relation juridique obligatoire découle directement de l'art. 307 du Code civil, qui donne la notion juridique générale d'obligation, y compris l'obligation en tant que relation juridique contractuelle : « Les obligations naissent d'un accord... ». Les normes de l'article ci-dessus du Code civil sont matérialisées dans de nombreuses dispositions de la législation civile consacrées à l'exécution et à la résiliation des contrats. Il est bien évident que dans les cas ci-dessus, nous ne parlons pas d'un contrat comme d'un accord (fait juridique) déjà conclu, mais d'un contrat comme d'une relation juridique obligatoire continue.
La notion de contrat comme relation juridique obligatoire permet d'en établir les caractéristiques qualitatives.
A. Une obligation contractuelle naît de la volonté des parties sur la base d'un accord entre elles. Dans une obligation civile, aucune des parties ne doit avoir d’autorité sur l’autre. Dans le cas contraire, le contrat civil lui-même pourrait être menacé.
B. L'obligation contractuelle en droit civil est un type de relation juridique entre des personnes spécifiques appelées créancier et débiteur. Ces noms ont une signification plutôt fonctionnelle, puisque dans la grande majorité des contrats civils (contrats bilatéraux) chaque partie est à la fois créancière et débitrice. Les notions de créancier et de débiteur sont directement liées aux droits et obligations des parties à une relation juridique obligatoire, et non à la position des parties dans l'obligation en tant que phénomène global.
B. Une obligation contractuelle vise à atteindre certains résultats juridiques (conséquences) qui relèvent des intérêts des parties au contrat et, dans les cas autorisés par la loi, également de tiers. Ainsi, dans un contrat d’achat et de vente, l’intérêt du vendeur est de vendre la chose qu’il possède au prix le plus élevé possible, et l’intérêt de l’acheteur est de l’acquérir au prix minimum acceptable.
Une obligation découlant d'un contrat civil ne devrait pas affecter les droits et intérêts légitimes des citoyens et des organisations qui ne sont pas directement impliqués dans le contrat.
Outre les obligations à contenu positif (l'obligation du débiteur d'accomplir un certain acte), la possibilité d'obligations à contenu négatif, en vertu desquelles le débiteur est obligé de s'abstenir de certains actes, est autorisée. Cependant, la législation civile actuelle ne connaît aucun type de contrat de ce type. Les éléments nécessaires de contenu négatif dans les obligations contractuelles qui ont un contenu généralement positif sont connus de la loi. Par exemple, le locataire n'a pas le droit de sous-louer le bien loué sans le consentement du bailleur.
D. Une obligation contractuelle est fondamentalement de nature patrimoniale. Son objectif principal est de servir de médiateur dans les relations économiques. Cependant, dans le droit civil, il n'existe pas de règles limitant le contenu d'une obligation contractuelle aux actions à caractère patrimonial. De plus, la législation civile, outre la législation immobilière, réglemente également les relations non patrimoniales. Il y a donc tout lieu de croire que le contenu d'une obligation contractuelle peut également être non patrimonial. Cette conclusion s'applique à la fois aux obligations dans lesquelles les droits et obligations non patrimoniaux ne constituent que des éléments individuels du contenu des obligations (il existe particulièrement de nombreuses obligations de ce type dans le droit d'auteur), et aux obligations de nature totalement non patrimoniale. Un exemple d'une telle obligation est l'obligation pour un avocat de défendre gratuitement le défendeur devant le tribunal, découlant du contrat de cession.
L'ensemble des caractéristiques énoncées d'une obligation contractuelle distingue un contrat civil des autres contrats connus du droit russe (constitutionnel, administratif, constitutif, etc.).
Un contrat en tant que concept intégré comprend un accord et une obligation contractuelle à toutes les étapes de son origine, de sa modification et de sa résiliation, ainsi que la forme documentaire de son existence. C'est en ce sens que cette notion de contrat est utilisée dans la section IV du Code civil, dédiée à certains types de contrats.
La liberté contractuelle devient l'un des principes fondamentaux du droit civil moderne lors du fonctionnement d'une économie de marché dans le pays. L'effet de ce principe est limité au stade de la conclusion d'un contrat. En d’autres termes, l’objet de son action est le contrat en tant que fait juridique : « Les citoyens et les personnes morales sont libres de contracter ».
En conséquence, la liberté contractuelle ne s’étend pas à la notion de contrat en tant que relation juridique. Dans ce domaine, les dispositions du Code civil concernant l'inadmissibilité du refus unilatéral d'exécuter une obligation s'appliquent. Les exceptions sont les accords dits de fiducie, dont un exemple est un contrat d'agence. Le mandant a le droit d'annuler la cession et l'avocat de la refuser à tout moment. Un accord de renonciation à ce droit est nul.
Cette catégorie comprend également un contrat de gestion fiduciaire immobilière, un contrat de services payants et quelques autres contrats prévus par le Code civil. Un refus unilatéral d'exécuter une obligation et une modification unilatérale des termes d'une telle obligation sont également autorisés lorsque les parties à l'accord exercent des activités entrepreneuriales, à condition que cela soit prévu par l'accord.
La liberté contractuelle signifie :
- 1) le droit d'une partie de conclure un accord, à la fois prévu et non prévu par la loi ou d'autres actes juridiques, y compris un accord mixte contenant des éléments de divers accords ;
- 2) le droit des parties de choisir la contrepartie au titre de l'accord ;
- 3) le droit des parties de déterminer les termes du contrat à leur propre discrétion, sauf dans les cas où le contenu de la condition concernée est prescrit par la loi ou d'autres actes juridiques.
Bien entendu, la liberté contractuelle ne peut être absolue. La contrainte de conclure un accord n'est pas autorisée, sauf dans les cas où l'obligation de conclure un accord est prévue par le présent Code, la loi ou d'autres actes juridiques. Ainsi, la conclusion d'un accord est obligatoire pour le client étatique, et dans certains cas précisés par le Code civil, également pour le fournisseur (interprète).
Lors de la définition de la notion de contrat civil, une grande importance est accordée à l'interprétation du contrat au stade de sa mise en œuvre. Dans le même temps, le législateur a adopté la position américaine sur l'interprétation du contrat, privilégiant l'expression de la volonté des parties sur leur volonté au stade de la conclusion du contrat. Lors de l'interprétation des termes d'un contrat, le tribunal prend en compte le sens littéral des mots et expressions qui y sont contenus. Le sens littéral des termes du contrat, s'il n'est pas clair, est établi par comparaison avec d'autres conditions et avec le sens du contrat dans son ensemble.
S'il est impossible de déterminer le contenu de l'accord en identifiant la volonté des parties sur la base du texte écrit de l'accord, il est permis d'utiliser toutes les circonstances accompagnant la conclusion et l'application de l'accord, y compris les négociations, la correspondance et les pratiques commerciales précédant la conclusion du contrat, les relations entre les parties, les coutumes commerciales et le comportement ultérieur sont établis par les parties après la conclusion du contrat.
Enfin, la dernière question concernait la notion de contrat comme relation juridique : la question de la durée du contrat. Le Code civil contient quatre valeurs permettant de déterminer la durée de validité du contrat. Premièrement, à titre général, il est prévu que le contrat entre en vigueur et devient contraignant pour les parties dès sa conclusion. Deuxièmement, les parties ont le droit de donner un effet rétroactif à l'accord conclu, en établissant que les termes de l'accord s'appliquent à leurs relations nées avant la conclusion de l'accord, en indiquant la date et le début de sa validité. Troisièmement, le Code civil contient une règle sur une alternative à la résiliation des obligations des parties en vertu du contrat. La loi ou le contrat peut prévoir qu'à l'expiration du contrat, les obligations des parties en vertu du contrat cessent également. S'il n'y a pas une telle condition dans la loi ou l'accord, l'accord est reconnu comme valable jusqu'au moment qui y est spécifié lorsque les parties remplissent l'obligation. Quatrièmement, après l'expiration du contrat en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations des parties, la relation juridique contractuelle entre dans la deuxième étape - celle de la responsabilité civile. L'expiration du contrat ne dégage pas les parties de leur responsabilité en cas de violation.
Le contrat d'auteur est de nature civile et est indépendant des autres contrats de droit civil. Cette conclusion n’a pas seulement une signification théorique, mais aussi une grande signification pratique. Cela signifie notamment que les relations contractuelles entre droits d'auteur sont soumises à la fois aux dispositions générales du droit civil, par exemple aux règles sur les formes et conditions de validité des transactions, et aux règles correspondantes du droit des obligations concernant, par exemple, le procédure de conclusion et d'exécution des contrats, responsabilité pour leurs violations, etc.
Le contrat d'auteur, comme tout contrat civil, est un accord entre deux ou plusieurs personnes visant à établir, modifier ou mettre fin à des droits et obligations mutuels. Toutes les règles du droit des obligations sont applicables à de tels accords, à l'exception de celles qui sont incompatibles avec les particularités des relations nées lors de l'utilisation des résultats de l'activité créatrice.
Entre-temps, le législateur n'a pas donné de définition juridique du contrat d'auteur, tel qu'un contrat d'achat et de vente ou de location, cependant, une analyse systématique des normes de la législation sur le droit d'auteur et, surtout, de la loi, permet de formuler une telle définition.
Un accord d'auteur est une autorisation d'utiliser une œuvre ou, en d'autres termes, un accord sur le transfert des droits de propriété sur une œuvre. Lorsqu’on définit un accord de droit d’auteur comme un « transfert de droits », il est nécessaire de se concentrer sur la différence entre une telle définition et le « transfert de droits ». La dernière catégorie caractérise les cas de « cession des droits contre la volonté de l’auteur » .
Ainsi, on peut formuler la définition suivante : un contrat d'auteur est un accord en vertu duquel une partie, l'auteur, transfère des droits de propriété à l'autre partie à l'utilisateur pour une durée déterminée par les parties et moyennant une certaine rémunération.
Selon de nombreux auteurs, le contrat d'auteur est un acte de volonté, fondé sur l'accord mutuel des parties, visant à l'émergence, au changement ou à la fin de relations juridiques. Par exemple, le professeur F.I. Gavze a exprimé l'opinion que le but de l'accord sur le droit d'auteur est de répondre au mieux aux besoins de l'ensemble de la société et de ses membres individuels.
M. Miroshnikova, étudiante de troisième cycle au Département de droit civil de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, a souligné que le concept d'accord de droit d'auteur doit être considéré comme un concept générique de transaction bilatérale, dont l'objectif principal et immédiat est l'acquisition par des tiers. parties d'une base juridique pour l'utilisation d'une œuvre, qu'il s'agisse d'un droit de propriété exclusif ou d'une autorisation, respectivement attribués ou délivrés par l'auteur ou d'autres titulaires du droit d'auteur . Elle explique en outre que le terme « d'auteur » met l'accent non pas tant sur la spécificité de la composition subjective, mais sur la spécificité du bien - l'œuvre par rapport à laquelle naissent des relations juridiques, régies par l'accord de droit d'auteur. Il convient de noter que cela s'applique à tous les contrats de droit d'auteur, à l'exception du contrat d'auteur, qui est conclu avec l'auteur.
La théorie de la « cession, de l’aliénation » du droit d’auteur a trouvé du soutien dans les œuvres des années suivantes. VIRGINIE. Kabatov croyait que l'auteur pouvait transférer à d'autres personnes son droit de publier l'œuvre et son droit à son intégrité.
Critiquant la théorie de la « concession », B.S. Antimonov et E.A. Fleischitz a souligné que le caractère exclusif des droits de l’auteur réside dans leur inaliénabilité, l’inaliénabilité de la personnalité de l’auteur pendant toute sa vie ou pendant la période déterminée par la loi dans des cas particuliers, ainsi que dans l’inadmissibilité du transfert des droits de l’auteur à une autre personne.
Pour résumer ce qui a été dit, une approche différente de la compréhension de l'accord sur le droit d'auteur a été décrite - non pas comme un moyen d'aliéner les droits d'auteur, mais comme un moyen de réaliser les droits appartenant à l'auteur. Après tout, au sens large, le droit d'auteur est un ensemble de règles du droit civil et d'autres branches du droit qui régissent les relations liées à la création et à l'utilisation d'œuvres scientifiques, littéraires et artistiques.
I.A. Vaksberg croyait qu'en vertu du contrat l'auteur autorisait la publication de l'ouvrage. À peu près à la même époque, l'idée a été exprimée que lors du transfert d'une œuvre à un organisme, l'auteur n'exerce que son droit de publier l'œuvre. Ainsi, une tendance différente se dessine dans l'interprétation du contrat d'édition : comme un accord sur l'utilisation d'une œuvre.
Il est à noter que le Code civil de la RSFSR de 1964 ne contenait pas une seule définition du contrat d'auteur. Ainsi, I. V. Savelyeva a défini l'accord d'auteur comme un accord sur l'utilisation par une organisation d'une œuvre scientifique, littéraire et artistique créée par l'auteur conformément aux besoins culturels de l'ensemble de la société, tout en respectant les droits personnels et de propriété de l'auteur. auteur . T.-N.-L. Fang a défini l'accord d'auteur comme un accord entre l'auteur et l'organisation utilisatrice concernant la création et l'utilisation d'œuvres scientifiques, littéraires et artistiques. .
Selon V. A. Dozortsev, en vertu d'un accord de droit d'auteur, une partie - l'auteur - autorise l'autre partie - l'utilisateur à utiliser l'œuvre ou lui accorde le droit de disposer de l'œuvre dans une certaine mesure, et l'utilisateur s'engage à payer l'auteur une rémunération pour l'utilisation ou l'octroi d'un tel droit .
Dans les Fondements de la législation civile de 1991, le contrat d'auteur a été défini comme un accord en vertu duquel l'auteur est tenu de créer conformément au contrat et de transférer l'œuvre commandée ou de transférer l'œuvre finie pour utilisation, et l'utilisateur est tenu d'utiliser ou commencer à utiliser l'œuvre de la manière prévue par le contrat dans la mesure stipulée par celui-ci et dans un certain délai et verser à l'auteur la rémunération fixée par le contrat. La loi actuelle de la Fédération de Russie sur le droit d'auteur et les droits connexes a encore une fois refusé de consolider une définition aussi détaillée de l'accord sur le droit d'auteur. Cependant, l'analyse de ses normes permet de formuler la définition suivante : en vertu d'un accord de droit d'auteur, l'auteur transfère ou s'engage à transférer à l'acquéreur ses droits d'utilisation de l'œuvre dans les limites et selon les modalités convenues par les parties.
S.A. Chernysheva, comparant la législation précédente avec la législation actuelle, note à juste titre qu'une nouvelle approche des droits de l'auteur par rapport à son œuvre a désormais été établie, associée à la séparation des droits personnels de non-propriété et de propriété de l'auteur. Dans la littérature juridique nationale, des discussions ont lieu depuis longtemps sur la distinction entre le droit à la paternité et le droit au nom de l'auteur, leur nature et leur importance indépendantes, ainsi que sur la nécessité de reconnaître le droit de l'auteur à la paternité en tant que droit. moyens d'identification. Maintenant, l'auteur a reçu ce droit. Le droit de l'auteur au nom est prévu comme un droit indépendant, permettant à l'auteur de choisir comment indiquer sa paternité par son vrai nom, son pseudonyme ou son nom anonyme. Les droits personnels non patrimoniaux de l'auteur comprennent le droit de publier l'œuvre sous quelque forme que ce soit, y compris le droit de révision et le droit de protéger l'œuvre, ce qui, de l'avis de S.A. Chernysheva, doit assurer la protection de la réputation de l’auteur .
On peut également souligner ici que dans les nouvelles conditions économiques, le rôle du contrat en général et de l'accord sur le droit d'auteur en particulier augmente. Tout d'abord, nous entendons l'impact que l'accord de droit d'auteur, en tant que forme juridique, a sur les relations réalisées. Dans le cadre de l'institution de la régulation « droit d'auteur » des relations patrimoniales et personnelles non patrimoniales, elle présente ses propres caractéristiques. Premièrement, ces relations sont associées à la création et à l'utilisation d'œuvres de créativité intellectuelle. Deuxièmement, l'utilisation de l'œuvre elle-même est autorisée sur la base d'un accord avec l'auteur ou ses successeurs, à quelques exceptions près prévues par les règles relatives à la libre utilisation de l'œuvre.
Cependant, selon la législation en vigueur, en fait, l'auteur ne transfère pas complètement le droit d'utilisation, se laissant le titre de titulaire du droit.
La situation actuelle Koretsky V.I. défini comme suit : « Le transfert par l'auteur... en vertu d'un contrat de ses pouvoirs individuels d'utiliser l'œuvre n'est... rien d'autre que l'autorisation donnée par l'auteur d'utiliser son œuvre pendant une certaine période selon les termes du contrat. » .
Il convient de noter qu'une approche large du concept d'accord sur le droit d'auteur est courante dans la théorie russe du droit d'auteur.
Ainsi, par exemple, cette définition du contrat d'auteur est donnée par M. Kirillov - "les accords conclus avec l'auteur concernant l'utilisation de son œuvre sont appelés accords de droit d'auteur" .
Ainsi, la loi fédérale actuelle « sur le droit d’auteur et les droits voisins » ne permet pas d’utiliser un accord comme forme d’aliénation du droit d’auteur, servant de base au transfert des droits de propriété de l’auteur.
Compte tenu de la notion de droit d'auteur et de sa nature juridique, il convient de noter que les contrats prévoyant le transfert du droit d'auteur doivent être qualifiés de droit d'auteur, même s'ils ne sont pas désignés comme tels. En particulier, dans de nombreux cas, des règles sur la cession du droit d'auteur sont incluses dans les contrats civils de vente, de location, de société simple, etc. ; alors l'accord doit être conforme aux exigences des accords de droit d'auteur.
A l'inverse, les contrats qui ne prévoient pas la cession du droit d'auteur ne peuvent être considérés comme des droits d'auteur, même s'ils sont appelés ainsi. Des exemples de tels accords comprennent les accords sur la publication d'œuvres aux frais de l'auteur. Il s'agit généralement d'accords contractuels typiques : l'auteur paie la maison d'édition pour reproduire son œuvre sous la forme d'un livre et devient propriétaire de la totalité de la diffusion du livre.
En analysant le contrat d'auteur, tous les experts soulignent son caractère civil et soulignent son indépendance par rapport aux autres contrats de droit civil. Cette conclusion n’a pas seulement une signification théorique, mais aussi une grande signification pratique. Cela signifie notamment que les relations contractuelles entre droits d'auteur sont soumises à la fois aux dispositions générales du droit civil, par exemple les règles sur les formes et conditions de validité des transactions, et aux règles correspondantes du droit des obligations, concernant, par exemple, la procédure de conclusion et d'exécution des contrats, la responsabilité en cas de violation, etc.
En règle générale, le contrat d'auteur est de nature réciproque et compensatoire. Mais la question se pose : un accord de droit d’auteur peut-il être gratuit ? Considérons cette question à l'aide d'un exemple tiré de la pratique, analysons-la et tirons des conclusions sur la base de ce qui précède. Ainsi, une certaine grande maison d'édition musicale a décidé de mettre en œuvre un projet assez coûteux visant à publier des collections thématiques de chansons de certains des auteurs les plus populaires sur cassettes audio et CD. À cette fin, la maison d'édition, conformément à la loi de la Fédération de Russie sur le droit d'auteur et les droits connexes, a élaboré un formulaire standard de contrat d'auteur, qu'elle a invité tous les auteurs participant au projet à signer. L'objet de l'accord était l'autorisation de l'auteur d'inclure gratuitement certaines de ses œuvres dans des supports audio produits par l'éditeur sous un titre général, par exemple « Meilleures chansons ». Par la suite, après la publication de la collection, la question s'est posée : les termes de ces accords de droits d'auteur contredisent-ils la loi ? Le droit de reproduire les œuvres a-t-il effectivement été transféré à l'éditeur ? Cette question est examinée en détail par l'avocat de la Communauté des auteurs russes E. Grigoryan.
Article 1 de l'art. 31 de la loi fédérale « sur le droit d'auteur et les droits voisins » détermine que le contrat de l'auteur doit prévoir des conditions essentielles telles que le montant de la redevance et la procédure de détermination du montant de la redevance pour chaque méthode d'utilisation de l'œuvre, la procédure et le calendrier de son paiement. Le montant de la rémunération est une condition essentielle du contrat d'auteur.
Cependant, dans ce cas, les parties ont convenu de céder gratuitement les droits d'auteur. Peut-on considérer qu'ils se sont ainsi mis d'accord sur une condition aussi essentielle du contrat que le montant des redevances, en le reconnaissant égal à zéro ? La législation de la Fédération de Russie fait une distinction entre ces types de contrats selon que la partie doit recevoir un paiement ou une autre contrepartie pour l'exercice de ses fonctions ou si elle s'engage à fournir quelque chose à l'autre partie sans recevoir un tel paiement ou autre contrepartie. Il est supposé que le contrat conclu par les parties a pour objet une compensation. Autrement dit, la gratuité du contrat doit être directement prévue par la loi, un autre acte juridique ou découler de l'essence même du contrat.
Malgré cela, dans certains cas, le législateur, afin d'apporter une clarté finale, inclut spécifiquement dans le texte de la norme juridique une indication de la rémunération du contrat. Par conséquent, la norme impérative de l’art. 31 de la loi selon laquelle le contrat d'auteur doit prévoir une condition aussi essentielle que le montant de la redevance, indique que le contrat d'auteur est un contrat rémunéré.
L'auteur de l'article écrit également que même si l'on interprète l'expression « autorisation d'inclure gratuitement dans une collection... des œuvres » dans un accord conclu par une maison d'édition musicale avec l'auteur comme un accord des parties sur le montant de la rémunération égal à zéro, cela rend d'une manière ou d'une autre l'accord gratuit, ce qui contredit les dispositions de la loi fédérale « sur le droit d'auteur et les droits connexes » et du Code civil de la Fédération de Russie. De l'art. 31« Sur le droit d'auteur et les droits voisins » il s'ensuit que si l'accord de droit d'auteur ne fixe pas une diffusion maximale de l'œuvre, la rémunération doit être déterminée en pourcentage des revenus. En outre, la loi susmentionnée indique directement tous les cas dans lesquels il est possible d'utiliser une œuvre sans conclure d'accord de droit d'auteur ni payer de redevances. Cette liste exhaustive ne serait pas nécessaire si les parties elles-mêmes pouvaient prévoir dans le contrat sa gratuité.
Ainsi, on peut conclure qu'une indication selon laquelle le contrat est gratuit ne peut être considérée comme un accord entre les parties sur le montant de la rémunération.
Il convient de noter que dans l'accord en question, les parties ont inclus une condition de gratuité, ce qui contredit directement les exigences de la loi. Selon le paragraphe 7 de l'art. 31 de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits connexes, les termes du contrat d'auteur qui contredisent les dispositions de la loi sont invalides. Ainsi, la condition de cession gratuite des droits d'auteur en vertu de ces accords est invalide, car elle contredit la loi.
L'essence des contrats analysés est le transfert gratuit des droits. Si l'auteur avait insisté pour obtenir un accord de compensation, la maison d'édition musicale ne l'aurait probablement pas conclu du tout. Il est donc impossible d’exclure simplement cette partie du texte de l’accord, car cela reviendrait à omettre la condition principale de sa conclusion. Mais, comme nous l'avons montré ci-dessus, la condition de gratuité du contrat d'auteur est invalide et, par conséquent, toutes les transactions en question doivent être déclarées invalides.
Ainsi, les contrats d’édition musicale avec les auteurs pourraient être déclarés invalides sans une seule condition de sauvegarde. Le texte des accords stipulait que la maison d'édition fournirait gratuitement à l'auteur un certain nombre de CD et de cassettes audio contenant la collection publiée. Si l'on revient aux dispositions de l'art. 423 du PS de la Fédération de Russie prévoit qu'en vertu d'un accord d'indemnisation, la partie doit recevoir un paiement ou une autre contrepartie. Cette contrepartie peut également s'exprimer dans le transfert de copies de l'œuvre. Par conséquent, malgré le mot « gratuit », les contrats peuvent en substance être reconnus comme rémunérés.
Dans des ouvrages spéciaux consacrés à la réglementation juridique des relations de droit d'auteur dans certains domaines de la créativité, les caractéristiques ont été révélées et les concepts de certains types d'accords de droit d'auteur ont été définis - édition, production, scénario, etc.
Il est également consensuel, puisque les droits de propriété sont accordés au moment de l’accomplissement de l’obligation du concédant de donner accès à l’œuvre découlant de l’accord de droit d’auteur.
Dans le même temps, les accords de droits d'auteur réels, unilatéraux et gratuits ne sont pas exclus. Un véritable accord de droit d'auteur se produit lorsque, simultanément au fait que les parties parviennent à un accord sur tous les termes nécessaires de l'accord, elles se fournissent également tout ce qui est dû en vertu de l'accord.
Il est important de dire que la loi n'interdit pas la cession gratuite du droit d'auteur dans le cadre d'un contrat. À première vue, cette conclusion s'écarte du paragraphe 1 de l'art. 31 de la loi de la Fédération de Russie « sur le droit d'auteur et les droits voisins », qui énumère parmi les termes essentiels du contrat de l'auteur la condition relative « au montant de la rémunération et à la procédure de détermination du montant de la rémunération pour chaque mode d'utilisation de l'œuvre ». , la procédure et le calendrier de son paiement. Cependant, de ce qui a été dit, il résulte seulement que la question des redevances est soumise à un accord obligatoire dans le contrat. Par conséquent, si les droits d'auteur sont transférés gratuitement par accord des parties, cela doit être expressément indiqué dans le contrat. A défaut, en raison de la présomption de prise en compte du contrat d'auteur, la condition relative à son prix ne sera pas considérée comme convenue.
Bien entendu, l'accord de l'auteur doit être distingué des autres formes de réglementation contractuelle des relations concernant la création et l'utilisation d'œuvres scientifiques, littéraires et artistiques. Mais dans la pratique, se pose souvent la question de la distinction entre droit d'auteur et contrat de travail, ce qui est d'une grande importance pour établir l'étendue des droits du créateur d'une œuvre de création et de son utilisateur. Si l'œuvre a été créée dans le cadre d'une mission officielle, les droits d'utilisation appartiennent à l'employeur, qui doit uniquement veiller au respect des droits personnels et patrimoniaux de l'auteur. Les éditeurs et les organisations scientifiques, éducatives et autres peuvent reproduire et distribuer ces œuvres à tout moment, dans n'importe quel volume, y compris la réédition d'œuvres, sans demander le consentement des auteurs. C’est pourquoi ils sont souvent directement intéressés à ce que leurs relations avec les auteurs soient considérées comme des relations de travail. Un exemple ici serait le suivant : la maison d'édition a conclu un accord avec P. pour préparer des diapositives pour un album photo. Lors de la réédition de l'album, la maison d'édition a refusé de verser une rémunération à l'auteur, invoquant le fait que les diapositives étaient la propriété de la maison d'édition, puisqu'un contrat de travail avait été conclu avec l'auteur. Pour preuve, la maison d'édition a indiqué que l'auteur avait été payé par ordre de paiement. Mais cela ne peut en soi avoir aucune signification pour déterminer la nature du contrat. La maison d'édition n'ayant fourni aucune autre preuve de l'existence d'une relation de travail avec l'auteur, ses arguments ont été déclarés non fondés par le tribunal et une rémunération pour la republication a été perçue en faveur de l'auteur.
Dans les cas où le contrat conclu par les parties, dans le cadre duquel une œuvre de création a été créée, ne contient pas d'indication claire sur sa nature professionnelle, une conclusion à ce sujet ne peut être tirée que si un certain nombre de conditions sont réunies. Tout d’abord, l’objet du contrat de travail est l’activité professionnelle du salarié correspondant à son poste et à ses qualifications. Il peut s'agir de nature créative, par exemple le travail d'un traducteur à temps plein pour une maison d'édition ou d'un photographe à plein temps pour un magazine, mais il est entendu que nous parlons de l'exercice d'une certaine fonction de travail, et non sur l'obtention d'un résultat créatif spécifique déterminé par accord des parties.
« Si une œuvre a été créée, bien que par un employé à temps plein d'une organisation, mais pas dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, l'auteur de l'œuvre bénéficie de tous les droits prévus par la loi, y compris le droit d'utiliser l'œuvre. .» Ainsi, Z., étant réalisateur d'un film de vulgarisation scientifique, en accord avec le scénariste, a écrit le texte de narration de ce film. Le studio a refusé de payer 3. une rémunération, invoquant le fait qu'il est un employé à temps plein du studio et qu'il reçoit un salaire pour son travail. Cependant, puisque Z. a prouvé que les tâches du metteur en scène ne comprennent pas la rédaction du texte de narration, sa demande a été satisfaite.
Ici, nous pouvons également dire qu'en termes de composition thématique, les accords de droit d'auteur diffèrent de certains autres accords liés à l'utilisation des œuvres. Par exemple, les relations entre les studios de cinéma et les organismes de distribution de films sont structurées selon le type de contrat d'achat et de vente. Les contrats conclus par un studio de cinéma avec un studio de télévision concernant la diffusion d'un film à la télévision revêtent le caractère d'un achat-vente ou d'un bail immobilier, selon la durée de diffusion du film à la télévision.
Dans le même temps, le critère de composition thématique, selon lequel l'une des parties à l'accord de droit d'auteur doit nécessairement être l'auteur ou une personne qui le remplace, n'élimine pas toutes les questions qui se posent en pratique.
Lors de la conclusion de contrats de création d'œuvres d'art, la question se pose de la distinction entre un contrat d'auteur et un accord contractuel. On sait que l'étendue des droits de l'auteur et de l'entrepreneur ne coïncide pas du tout ; en particulier, l'entrepreneur exécute le travail à ses propres risques, le résultat de son travail est transféré à la propriété du client, qui ne le fait pas. assumer d'éventuelles responsabilités supplémentaires envers l'entrepreneur en relation avec l'utilisation ultérieure du résultat, etc. Par exemple, selon Par rapport à un entrepreneur, l'auteur est dans une bien meilleure position, car en cas d'échec créatif, il peut être garanti une certaine partie de la rémunération stipulée par le contrat, il conserve tous les droits d'auteur fondamentaux sur l'œuvre qui devient la propriété d'autrui, etc.
La distinction entre le droit d'auteur et les accords contractuels se fait principalement par leur objet. Si l'objet d'un contrat est le résultat des activités techniques habituelles de l'entrepreneur, alors l'objet d'un contrat d'auteur est, par exemple, des œuvres scientifiques, littéraires, artistiques résultant du travail créatif de l'auteur. En pratique, il n’est pas si simple de les distinguer les uns des autres.
Cette question se pose avec plus d'acuité lors de la conclusion de contrats pour la production de copies d'œuvres d'art, de science et de littérature, y compris des contrats pour la production de copies dites protégées par le droit d'auteur. En science juridique, on soutient souvent qu’une copie, y compris celle d’auteur, est le résultat d’un travail ordinaire, pour l’exécution duquel un contrat doit être conclu. Mais parfois, il n’est pas possible de faire la distinction entre les droits d’auteur et les accords contractuels en fonction de leur objet.
Les accords prévoyant le transfert du droit d'auteur doivent être classés comme droits d'auteur, même s'ils ne sont pas désignés comme tels. En particulier, dans de nombreux cas, des dispositions légales sur le transfert du droit d'auteur sont incluses dans les contrats civils de vente, de location, de société simple, etc. - l'accord doit alors être conforme aux exigences des accords de droit d'auteur. A l'inverse, les contrats qui ne prévoient pas la cession du droit d'auteur ne peuvent être considérés comme des droits d'auteur, même s'ils sont appelés ainsi. Des exemples de tels accords comprennent les accords sur la publication d'œuvres aux frais de l'auteur. Il s'agit généralement d'accords contractuels typiques - l'auteur paie la maison d'édition pour la reproduction de son œuvre et devient propriétaire de la totalité de la diffusion du livre.
Gavrilov E.P. Commentaire article par article de la loi de la Fédération de Russie « sur le droit d'auteur et les droits connexes ». - M. : Fondation Culture Juridique, 1996.
Savelyeva I.V. Réglementation juridique des relations dans le domaine de la créativité artistique. M., 1986. P. 111.
Klyk N.L. Protection des intérêts des parties dans le cadre de l'accord de droit d'auteur. Krasnoïarsk, 1987 P. 12.
Dozortsev V.A. Sujets de droits exclusifs. // Recueil d'articles. Droits intellectuels : notion. Système. Tâches de codification. / Recherche Centre de droit privé. – M. : « Statut », - 2003. – 416С. - P. 295.« Sur le droit d'auteur et les droits voisins » du 19.07.95. N 110-FZ
Droit de la propriété intellectuelle dans la Fédération de Russie : manuel. – 2e éd., révisée. Et supplémentaire – M. : TK Velby LLC, 2003, p. 266.
Le contrat est l’une des structures juridiques les plus anciennes. Auparavant, dans l'histoire du droit émergent des obligations, seuls les délits étaient apparus. Étant par nature une réaction négative de la part de l'État aux écarts par rapport à ses propres critères de comportement correct, les délits étaient l'héritier direct de l'un des vestiges les plus dégoûtants du système tribal : la vengeance. Le développement de diverses formes de communication entre les personnes a mis en avant la nécessité de leur donner la possibilité, selon la volonté convenue par les parties, d'utiliser celles proposées par le législateur ou de créer elles-mêmes des modèles juridiques. Les accords (contrats) sont devenus de tels modèles. Pendant un certain temps, les délits et les contrats furent les seuls motifs d'émergence d'obligations reconnues par l'État.
À l'apogée du droit romain, l'étroitesse de la formule à deux termes des motifs d'émergence des obligations est devenue de plus en plus claire et, par conséquent, Justinien, et après lui Guy, ont exprimé l'idée de la nécessité d'au moins deux groupes supplémentaires. de motifs : quasi-délits et quasi-contrats. Cependant, même dans ces conditions, alors que la division en quatre parties des obligations civiles était déjà fixée, le contrat continuait à jouer un rôle prédominant dans leur système. De plus, l'importance du traité augmentait de plus en plus. Ce n'est pas un hasard si l'un de ceux exprimés au 19ème siècle. les idées concernant les perspectives de développement du droit civil étaient que « le contrat occupe les neuf dixièmes des codes actuels, et un jour tous les articles du premier au dernier des codes lui seront consacrés ».
Dans notre pays, à l'époque soviétique, la plupart des contrats - ceux qui liaient entre eux les principaux acteurs du chiffre d'affaires économique de l'époque - l'État, ainsi que les coopératives et autres organismes publics - étaient conclus pour l'exécution ou l'exécution d'actes planifiés. La volonté des contreparties à de tels accords s'est formée sous l'influence directe ou indirecte de missions émanant d'agences gouvernementales. Ainsi, l'accord a perdu sa caractéristique principale et constitutive : il ne pouvait être considéré que comme le résultat d'un accord conclu par les contreparties uniquement avec un haut degré de conditionnalité. Enfin, la limitation maximale de l'importance du modèle contractuel en tant que tel a été facilitée par le fait que presque toutes les règles en vigueur dans ce domaine avaient un caractère absolument obligatoire (impératif).
La tendance à l'augmentation du rôle du contrat, caractéristique de tout droit civil moderne, a commencé à se manifester ces dernières années dans un volume toujours croissant. Cette tendance est principalement associée à une restructuration radicale du système économique du pays. La reconnaissance de la propriété privée et son occupation progressive des hauteurs dominantes de l'économie, le rétrécissement de la régulation étatique de la sphère économique aux limites nécessaires, l'instauration de la liberté de choix des entrepreneurs et la mise en œuvre de d'autres principes fondamentaux de la nouvelle législation civile.
Le recours aux contrats depuis plusieurs milliers d'années s'explique, entre autres, par le fait qu'il s'agit d'une forme juridique flexible dans laquelle peuvent s'incarner des relations sociales de nature différente. L'objectif principal de l'accord est de réglementer, dans le cadre de la loi, le comportement des personnes en indiquant les limites de leur comportement possible et approprié, ainsi que les conséquences de la violation des exigences pertinentes.
À une certaine époque, trois points de vue ont été exprimés quant à l’importance relative du droit et du traité. Les partisans de la « théorie volontaire » pensaient que le contrat en tant qu'acte volontaire des contreparties était la source principale et que la loi ne faisait que reconstituer ou limiter leur volonté. Ceux qui ont présenté la théorie de la priorité de la loi sont partis du fait que le contrat n'a qu'un effet juridique dérivé de la loi. Enfin, les partisans de la troisième « théorie empirique » pensaient que la volonté des parties ne visait consciemment qu'un certain effet économique ; dans le même temps, les conséquences du contrat sont conçues comme des moyens de sa mise en œuvre, dont les parties peuvent ne pas avoir et, d'ailleurs, n'ont souvent pas une idée claire.
Le rôle régulateur du contrat le rapproche de la loi et de la réglementation. Les termes du contrat diffèrent de la norme juridique principalement par deux caractéristiques fondamentales. La première est liée à l’origine des règles de conduite : un contrat exprime la volonté des parties, et un acte juridique exprime la volonté de l’organisme qui l’a émis. La seconde distingue les limites d'action des deux règles de conduite : le contrat est directement conçu pour réguler le comportement de ses seules parties - pour celles qui ne sont pas parties, il peut créer des droits, mais pas des obligations ; en même temps, un acte juridique ou autre acte normatif génère, en principe, une règle commune à tous (toute limitation du cercle de personnes auxquelles s'applique l'acte normatif est déterminée par celui-ci). Les deux caractéristiques relevées distinguent un contrat civil.
Un accord constitue une forme d'activité idéale pour les participants aux transactions civiles. Il est important de souligner que, malgré l'évolution de son contenu socio-économique, au cours de l'histoire de la société, la conception du contrat lui-même, en tant que produit de la technologie juridique, reste fondamentalement très stable.
Le contrat civil a une longue histoire. Ses formes classiques se sont développées dans la Rome antique et ont été testées dans diverses formations de la société civilisée. Cependant, il n’existe toujours pas de conception unique de ce phénomène. Essayons de comprendre le concept de contrat et son essence.
La vision des contrats (contractus) qui existait en droit romain permettait de les considérer sous trois points de vue : comme fondement de l'émergence d'une relation juridique, comme relation juridique elle-même née de cette base, et, enfin, comme la forme que prend la relation juridique correspondante. Contractus vient du verbe contrahere, qui signifie « contracter ». Le terme contractus est donc, dans une certaine mesure, adapté à la notion de relation juridique en tant que telle. Et ce n'est qu'après la division des motifs d'émergence des obligations en contrats et délits que le contractus a commencé à être considéré comme une convention (accord) exécutoire, contrairement au même accord dépourvu de protection (pactum).
La législation civile de nombreux pays étrangers part du fait qu'un contrat est un accord. Ainsi, dans l'art. 1101 du Code civil fédéral, un contrat est un accord par lequel une ou plusieurs personnes s'engagent envers une ou plusieurs autres personnes à donner quelque chose, à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose. MM. Agarkov, se référant aux derniers mots de cet article, a souligné qu'il repose sur le concept romain d'obligation.
Le Code civil néerlandais reconnaît qu'un contrat est « une transaction multilatérale dans laquelle une ou plusieurs parties assument des obligations envers une ou plusieurs autres parties » (article 213 du livre 6).
L'une des rares exceptions est le GGU dans le sens où il fonctionne avec la notion d'« accord » comme étant donné une fois pour toutes et n'ayant pas besoin d'être clarifié. En fait, la première mention de l'accord est contenue dans l'art. 126, consacré à la forme écrite établie par la loi (avant cela, l'article 108 traite du contrat dans le cadre de la détermination des limites de la capacité juridique des mineurs).
La question du contrat dans le système de common law anglo-américain est résolue différemment. Dans ce système, la notion de contrat est développée par les tribunaux de droit commun.
Un contrat est interprété comme une promesse (promesse) ou une série de promesses (ou un ensemble de promesses) ou comme une garantie (assurance) qu'une partie (promettant), la personne qui donne l'obligation, donne à une autre personne (le promettant). G. Lask a donné la définition suivante d'un contrat : « Un contrat est une promesse ou une série de promesses, pour la violation de laquelle la loi prévoit une sanction ou dont la loi considère, dans un certain sens, comme une obligation. .»
Il convient cependant de noter que la doctrine moderne et le droit anglo-américain abandonnent progressivement la conception classique du contrat comme promesse ou expression unilatérale de la volonté d'une personne dont l'exécution est assurée par la loi. De plus en plus souvent, dans la doctrine et le droit anglo-américains, un contrat est interprété de la même manière que dans le système juridique romano-germanique, et est défini comme un accord. Dans l'art. 1-201/11 du Uniform Commercial Code des États-Unis stipule : « Il s’agit d’une obligation légale dans son ensemble découlant de l’accord des parties conformément à la présente loi et aux autres règles de droit applicables. » Dans le livre « Contrats » d'E. Farnsworth, un contrat est considéré comme un accord qui crée des obligations garanties ou acceptées par la loi.
C’est étrange, mais c’est un fait que la législation de l’ex-URSS et des républiques fédérées ne contenait pas de définition juridique claire du contrat civil.
GC R.S.F.S.R. , Fondements de la législation civile de l'URSS et des républiques fédérées de 1961, codes civils des républiques fédérées adoptés conformément à ces Fondements, Fondements de la législation civile de l'URSS et des républiques fédérées de 1991. appelé contrats transactions bilatérales ou multilatérales et stipulait qu '«un contrat est considéré comme conclu lorsqu'un accord sur toutes les conditions essentielles est conclu entre les parties dans la forme requise dans les cas appropriés.
Dans la littérature juridique soviétique et post-soviétique, l'idée multiconceptuelle ci-dessus d'un contrat est développée de manière assez cohérente dans les travaux d'un certain nombre d'auteurs. Ceci est particulièrement clairement exprimé dans les études d'O.S. Ioffé. Reconnaissant le contrat comme un accord de deux ou plusieurs personnes sur l'émergence, la modification ou la fin de relations juridiques civiles, O.S. Ioffe, en même temps, a noté : « Parfois, un accord est compris comme l'obligation elle-même découlant d'un tel accord, et dans certains cas, ce terme désigne un document enregistrant l'acte de survenance d'une obligation au gré de tous ses participants. »
Un autre exemple d'opinions exprimées dans la littérature peut être donné : N.D. prend une position particulière. Egorov. « Par contrat », souligne-t-il, « ils entendent à la fois le fait juridique qui sous-tend l'obligation, l'obligation contractuelle elle-même et le document dans lequel est fixé le fait d'établir une relation juridique obligatoire ». Dans le même temps, la littérature identifie parfois des idées différentes sur le contrat.
Ainsi, dans le manuel édité par E.A. Sukhanov 1993 note : « Un accord est généralement interprété comme une transaction bilatérale ou multilatérale. Mais réduire le contrat à une seule transaction n’est guère correct. Une transaction est une action visant à établir, modifier, mettre fin à des droits ou à des obligations. L'accord établit non seulement des droits et des obligations, mais prévoit également l'accomplissement d'actions substantielles par les sujets, dont le contenu est fixé dans l'accord. Le contrat définit exactement ce qui doit être fait et quelles sont les exigences légales auxquelles les parties doivent répondre pour exécuter les actions. Par conséquent, le rôle et les fonctions du contrat sont beaucoup plus larges que ceux d’une transaction traditionnellement comprise.
Un autre point de vue sur la question à l'étude a été exprimé par R.O. Khalfina. Elle s'est simultanément opposée à l'affirmation selon laquelle un accord est une transaction mutuelle, et au fait qu'un accord est le consentement des parties visant à l'émergence, à la modification ou à la fin d'une relation juridique civile. R.O. elle-même Halfina pensait que le concept de contrat, en plus de coordonner la volonté de deux ou plusieurs personnes, « doit inclure leurs droits et obligations civils mutuels ». Dans le même temps, l'attention est attirée sur le fait que « les droits et obligations assumés par chacune des parties sont, en règle générale, différents, mais ils doivent être mutuellement convenus et doivent, dans leur ensemble, donner un résultat juridique unique ». .» Il semble que l’idée de combiner droits et obligations dans un contrat ne puisse en soi soulever d’objections. Cependant, tout cela ne doit pas être attribué à l'accord transactionnel, mais à l'accord sur la relation juridique. De plus, dans toute relation juridique, contractuelle et non contractuelle, quel que soit le fait juridique particulier qui a servi de base à sa survenance, les droits et obligations doivent correspondre les uns aux autres. Cela est nécessaire car sinon, la relation juridique en tant que telle ne pourrait pas exister du tout. Par conséquent, la fonctionnalité proposée ne peut évidemment pas jouer un rôle de mise en valeur de la structure contractuelle en tant que telle.
O.A. était également opposé au concept multiconceptuel du contrat, mais pour d’autres raisons. Des gens beaux. Il croyait que « dans notre législation civile, ainsi que dans la science du droit, lorsqu'on utilise le terme « accord », deux concepts différents sont confondus : l'accord en tant que fait juridique et en tant que forme d'existence d'une relation juridique. Développant cette position, O.A. Krasavchikov est arrivé à la conclusion : « Il ne fait aucun doute que des interprétations aussi différentes d'un même terme ne peuvent que conduire à divers malentendus et difficultés d'ordre théorique et pratique. »
L’auteur n’a cependant pas montré quelles sont exactement les « difficultés » en question. Quoi qu'il en soit, le législateur n'a pas accepté cette recommandation et, lors de l'adoption du Code civil de la BSSR, ainsi que de l'actuel Code civil de la République de Biélorussie, conformément à la pratique généralement acceptée, a retenu un seul terme - « accord ».
La définition juridique du contrat est donnée dans la première partie du Code civil, adoptée lors de la cinquième réunion plénière de l'Assemblée interparlementaire des États membres de la Communauté des États indépendants (Code civil modèle). « L'accord reconnaît », est écrit dans la partie 1 de l'art. 415 du Code civil modèle, est un accord entre deux personnes ou plus pour établir, modifier ou mettre fin aux droits et obligations civils. Cette définition a été déplacée sans modification de l'article 1, partie 1, art. 420 du Code civil de la Fédération de Russie et au paragraphe 1 de l'art. 390 Code civil de la République du Bélarus.
La définition juridique, tout comme les définitions doctrinales données, présente un inconvénient. On oublie que la volonté de chacune des personnes signataires du contrat, bien que visant à atteindre le même objectif (par exemple, conclure un contrat de prêt), diffère dans son essence (on veut prêter de l'argent et percevoir des intérêts sur le capital, l’autre contracte un emprunt et s’engage à payer un pourcentage fixe). Leurs expressions de volonté sont dans des directions opposées. En d’autres termes, ce ne sont pas seulement des personnes participant à l’accord, mais également des parties à l’accord conclu avec des droits et des obligations inégaux. Ce n'est que si la volonté des parties qui concluent un accord est opposée que l'on peut dire que leur accord donne naissance à des droits et obligations civils. Par conséquent, cela ne peut pas être appelé un accord, par exemple un accord entre époux (et il s'agit de deux personnes) pour offrir quelque chose à leur fils le jour de son anniversaire. Ce n'est que si la volonté des parties qui concluent un accord est opposée que l'on peut affirmer que leur accord donne naissance à une relation juridique civile, même s'il entraîne des conséquences juridiques. Le consentement des époux à adopter un enfant ne constitue donc pas un contrat. Certes, il existe des accords dans lesquels coïncident non seulement le but, mais aussi la direction des expressions de la volonté des personnes participant à la coordination des volontés. Il s'agit par exemple d'un accord sur des activités communes et d'un accord constitutif. Cependant, dans un tel accord, chacune des personnes concluant l'accord agit en tant que partie indépendante ayant ses propres intérêts.
Ainsi, l'étude d'un contrat civil est réalisée afin d'identifier ses caractéristiques comme 1) un fait juridique et ses différences par rapport aux autres faits juridiques (actions, actes administratifs, préjudices, événements), 2) divulgation de son contenu en tant qu'obligation civile. et 3) définir sa forme comme un document contenant les termes de la transaction conclue avec une description des droits et obligations de chaque partie.
Objet de l'accord. Une compréhension claire des différents contenus conceptuels du terme « accord » nous permet de résoudre le problème de la définition et de la distinction de concepts tels que « sujet » et « objet » de l'accord.
Objet de l'accord. Le Code civil actuel, contrairement à son prédécesseur, le Code civil de la BSSR de 1964, ne citait qu'une condition relative à l'objet du contrat comme condition essentielle obligatoire pour un contrat civil (article 402 du Code civil). Cependant, le Code civil ne définit pas l'objet de l'accord, s'en remettant à la pratique et à la doctrine des forces de l'ordre. De plus, le Code civil introduit la notion d'« objet » du contrat, sans en divulguer également le contenu. En règle générale, les catégories « objet » et « objet du contrat » sont identifiées. Par exemple, le paragraphe 1 de l'article 896 du Code civil de la République de Biélorussie intitulé « Objet d'un accord de gestion fiduciaire immobilière » stipule que « l'objet de la gestion fiduciaire peut être des entreprises et autres complexes immobiliers, des objets individuels liés à l'immobilier, titres, droits certifiés par des titres sans papiers, droits exclusifs et autres biens.
Malheureusement, la doctrine n'a pas d'interprétation unifiée de l'objet d'un contrat civil. La plupart des auteurs se limitent à définir l'objet de certains types de contrats, comprenant par exemple l'objet d'un contrat d'achat et de vente comme des « biens meubles et immeubles », et l'objet d'un contrat d'agence comme « l'exécution par un mandataire de les actions en justice entraînant l'émergence, la modification ou la cessation des droits et obligations subjectifs du mandant " UN. Obydennov arrive à la conclusion que « l'objet du contrat est un objet du monde matériel (chose, propriété) ou immatériel, auquel la volonté des parties contractantes est directement dirigée ou directement liée et qui est suffisamment individualisé pour le distinguer de d'autres objets. Plusieurs auteurs arrivent à la conclusion que l’objet du contrat est complexe. Ce concept est adopté par M.I. Braginsky (ou Vitryansky), qui estime que les contrats visant le transfert de propriété « ont un sujet complexe, comprenant à la fois les actions des parties obligées, y compris le transfert et l'acceptation de la propriété (objet du premier type), et la propriété elle-même. (objet de seconde espèce)". FI. Gavze entend par sujet de tout contrat civil les actions que le débiteur doit accomplir et l'objet vers lequel ces actions sont dirigées.
La distinction entre les catégories « sujet » et « objet » d'un contrat doit être opérée en fonction du caractère multidimensionnel de la notion même de « contrat ». Le contenu du contrat - transaction est constitué des conditions (clauses) selon lesquelles la volonté convenue des parties est réalisée, visant à l'émergence de droits et d'obligations, à l'émergence d'une relation juridique obligatoire. Le contenu du contrat en tant que relation juridique concerne directement les droits et obligations des parties.
Partant du fait qu'un accord est considéré à la fois comme une transaction et comme une relation juridique, nous pouvons conclure que dans le cadre d'une relation accord-juridique, nous devrions parler de l'objet, et dans le cadre d'un accord-transaction - de l'objet de l'accord.